-
< 10mnintermédiaire
Cet article publié sur la revue du CNRS revient sur les découvertes de ces dernières décennies. Compas céleste, chronomètre interne et mémoire exceptionnelle permettent à certains animaux de se projeter aussi bien dans le passé que dans le futur pour prendre des décisions.
-
< 5mnintermédiaire
La force des preuves nous amène à conclure que les humains ne sont pas seuls à posséder les substrats neurologiques de la conscience. Des animaux non-humains, notamment l’ensemble des mammifères et des oiseaux ainsi que de nombreuses autres espèces telles que les pieuvres, possèdent également ces substrats neurologiques.
-
Ce texte est celui d’une conférence donnée par P. Singer à Paris en 1991. Sections : L’obstacle que représente la question de la subjectivité des jugements moraux ; L’exigence de non-contradiction ; L’exigence d’universalisabilité
-
< 15mnexpert
A quel point devrions-nous être confrontationnels dans notre activisme?
Mots clés : Action directe, violence, sentience institute -
< 5mnexpert
Devrions-nous accorder plus de poids aux résultats à long terme ou aux résultats à court terme ?
Traduction depuis le Sentience Institute -
> 30mnexpert
Ce mémoire de linguistique de Louise Billoud étudie l’ampleur du phénomène végane, les différentes formes graphiques utilisées, les contextes variés d’occurrence, la teneur du contenu, les néologismes formés à partir de la racine VEG-, les thématiques qui y sont le plus souvent rapportées.
-
> 30mnexpert
Fabien Carrié restitue la genèse et la carrière de la notion de végéphobie pour en comprendre les logiques de formalisation. En traduisant les résistances rencontrées comme autant d’expressions d’un système généralisé d’oppression, il s’agit de redéfinir partiellement l’entreprise de représentation politique afin d’y inclure également les représentant·e·s revendiqué·e·s des animaux.
-
> 30mnintermédiaire
Eddy Fougier (spécialiste des mouvements protestataires) donne un point de vue extérieur sur la situation du mouvement abolitionniste Français en 2018. Sections : Historique ; Caractéristiques (propos, visions, modes opératoires) ; 3 pôles (véganisme, antispécisme, libération animale) ; 3 mouvements (économie végane, assos sensibilisatrices, groupes d’action) ; Impopularité et influence.
Commentaires (1)
Un politologue qui sort un dossier de 32 pages mais utilise encore une définition absurde du spécisme. Sinon c'est intéressant pour les gens qui ne connaissent pas le mouvement. La description est assez objective, bien qu'on ne perçoive pas trop quels sont les pôles ou courants majoritaires ou minoritaires, et que les actes conflictuels soient mis en avant. -
< 5mnintermédiaire
Des chercheurs de l’Inra démontrent l’impact de la concurrence alimentaire des colonies d’abeilles domestiques sur les abeilles sauvages en milieu naturel. Ces travaux révèlent l’existence d’une zone d’influence autour de chaque rucher et peuvent être mis à profit pour organiser la cohabitation entre les différentes populations d’abeilles.
-
< 10mnintermédiaire
De plus en plus d’études démontrent l’existence de cultures animales et de transmissions sociales au sein d’une même espèce. Ils sont capables d’utiliser et fabriquer des outils, ainsi que planifier leur utilisation. Même certains insectes sont capables d’apprentissage social sophistiqué – la clé de toute tradition culturelle dans un groupe – et de conformisme.
-
Dans ce texte, Richard Monvoisin et Timothée Gallen questionnent la portée épistémologique et morale du concept d’espèce. Leur constat : il s’agit d’une catégorie pratique mais arbitraire, porteuse de scories intellectuelles et éthiques. Faut-il alors s’en débarrasser ?
-
< 5mnexpert
Cet article du chercheur en psychologie sociale Gordon Hodson liste les principales conclusions des études de 2017 à 2019 sur les préjugés et discriminations envers les végéta*iens. Il traite de l’intensité de la végéphobie (supérieure au rejet de nombreux autres groupes sociaux) et des facteurs qui l’influence (bord politique, empathie envers les animaux, genre, raison du végéta*isme…).
Commentaires (2)
Voir aussi : http://estivareus.com/blog/MacInnisHodson_2015/ -
> 30mnexpert
Par Romain Espinosa. Pourquoi les économistes devraient-ils s’intéresser à la question de la consommation de produits d’origine animale ? Quelle peut être la contribution de l’économie aux discussions académiques existantes ? Quelles raisons peuvent expliquer le peu d’intérêt porté jusque-là par les économistes à cette problématique ?
-
< 30mnexpert
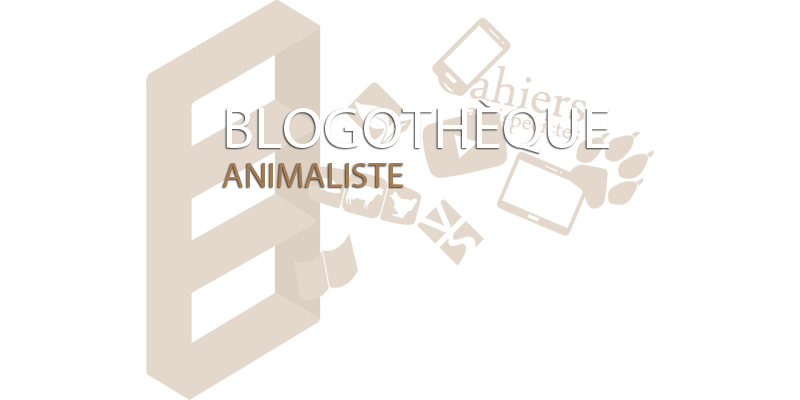
Une critique de l’idée de Nature et de la manière dont elle s’inscrit dans les discours normatifs. La Nature joue en particulier un rôle important dans la justification du spécisme.
Mots-clés: spécisme, nature, critique. -
> 30mnexpert
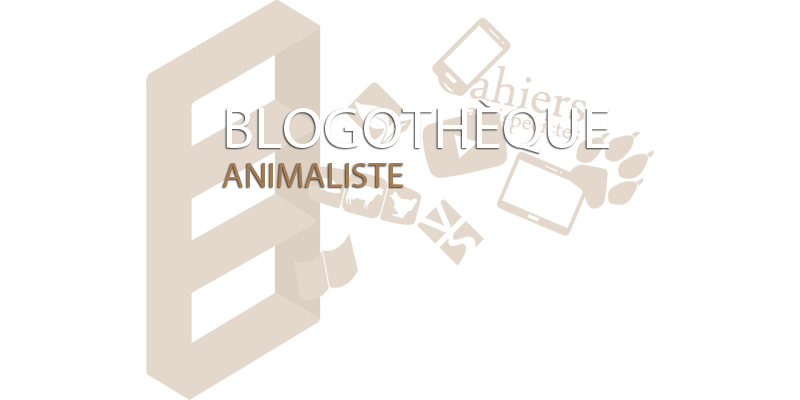
Sections: Les raisons d’explorer la vie mentale des animaux, 4 façons d’explorer les phénomènes mentaux : (1) la phénoménologie humaine ; (2) l’étude du comportement animal ; (3) des arguments de type fonctionnel-évolutionniste ; (4) les données physiologiques, Le rôle de l’éthologie cognitive
-
> 30mnexpert
Nous allons nous intéresser plus particulièrement au statut moral des animaux : quelle considération morale leur doit-on ? Doivent-ils être inclus dans le périmètre ou rester au-delà ? Cet essai va aborder la question d’éthique normative de savoir où doit s’arrêter notre considération morale.
-
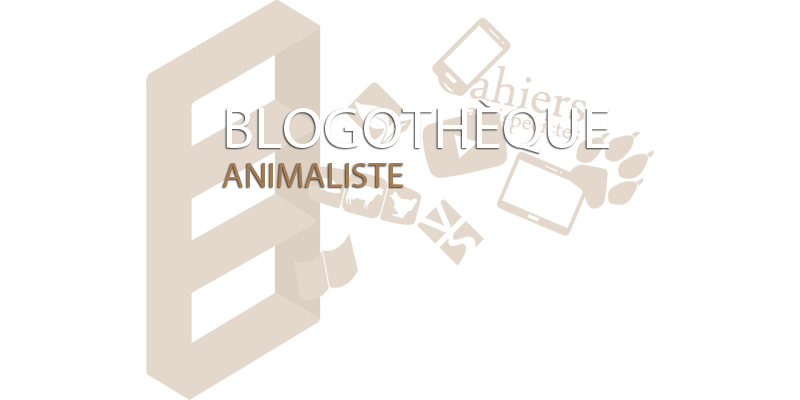
Axelle Playoust-Braure nous aide à rompre avec notre conception intuitive de l’espèce. 1/ Les espèces n’existent pas; 2/ La sociologie permet de parler d’ « espèce sociale »; 3/ pas de différence de nature, mais 4/ une différenciation sociale entre humains et non-humain-e-s.
Mots-clés: audio, espèce, sociologie. -
< 30mnexpert
Nicolas Treich (Inra) consacre un document de travail à l’analyse économique du véganisme. Un bilan du marché est d’abord dressé, pour analyser ensuite les externalités négatives des produits d’origine animal. L’efficacité des stratégies des associations de protection animale pour sensibiliser l’opinion est ensuite discutée, pour terminer sur une réflexion prospective autour de trois scénarios.
-
> 30mnexpert
Christiane Bailey soutient que certains animaux appartiennent à la communauté morale dans les deux sens : (1) ils sont des patients moraux dignes de considération morale directe et équivalente, mais également (2) des agents moraux au sens où ils sont capables de reconnaître, d’assumer et d’adresser aux autres des exigences minimales de bonne conduite et de savoir-vivre.
-
< 30mnintermédiaire
Dans cet extrait de son introduction à la philosophie intitulée Knowledge, Reality, and Value, Michael Huemer discute les principaux arguments pour et contre la consommation de produits animaux. Il y aborde le problème de la souffrance liée à l’élevage, propose différentes analogies pour comprendre le problème et contre-argumente 17 objections éthiques courantes au végétalisme.









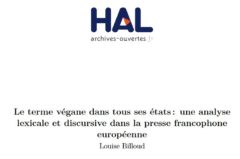
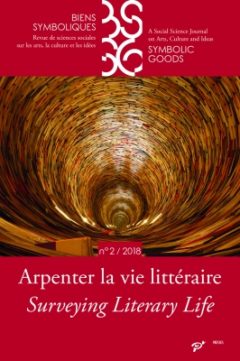
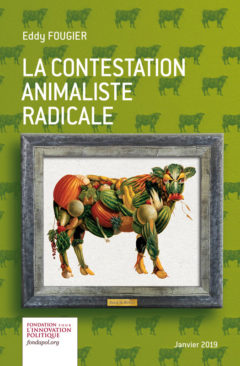




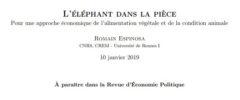





Commentaires (0)