-
< 5mnintermédiaire
Alors que de très nombreux animaux vivent dans des élevages intensifs, près de neuf Français sur dix se prononcent contre ces élevages. Ceci peut s’expliquer par le manque de crédibilité envers les labels, le montant à dépenser, le boycott de tout produit d’élevage, l’indisposition à faire un sacrifice personnel alors qu’on souhaite un changement global et l’absence de réflexion lors des achats.
-
< 10mnintermédiaire
L’engagement en faveur des causes animales et les marques d’empathie envers les animaux semblent factuellement beaucoup plus féminins que masculins. A l’inverse, les comportements violents sont davantage masculins. Cette empathie sexuée se retrouve aussi chez d’autres mammifères et chez les nouveaux nés. La variabilité interindividuelle et la culture peuvent aller contre cette tendance.
-
< 5mnintermédiaire
Selon Frédéric Mesguich, les défenseurs de l’idéologie spéciste évitent sa remise en question en présentant la domination humaine comme une nécessité vitale (à travers la consommation de viande) et en invisibilisant ses victimes. L’existence d’une idéologie est mise en évidence par les tentatives de convaincre les enfants du bienfondé à manger des animaux.
-
> 30mnexpert
Greenpeace dénonce dans un rapport de 150 pages les liens entre les défenseurs d’une alimentation carnée avec les milieux politiques, éducatifs ou médicaux, tentant de convaincre que l’élevage industriel n’existe pas ou encore que consommer moins de viande n’est pas nécessaire.
Commentaires (1)
Résumé ici : https://reporterre.net/Le-lobby-de-la-viande-defend-son-bifteck -
< 5mnexpert
Selon diverses recherches, l’empathie humaine est d’autant plus grande qu’il existe de similarité physiques entre les humains et les autres animaux considéré. Nous adhérons d’autant mieux à la maxime « tu ne tueras point » (même pour sauver un plus grand nombre) que l’animal est phylogénétiquement proche de nous. Les enfants sont moins susceptibles à ce favoritisme.
-
< 5mnintermédiaire
Les parents seraient les principaux responsables de cette ignorance, en n’osant pas expliquer aux enfants l’abattage des animaux. Deux tiers des enfants classent les mammifères (cochon, boeuf…) comme non comestibles. Les chercheurs estiment que c’est en grandissant que ces enfants acquièrent des croyances carnistes.
-
< 10mnintermédiaire
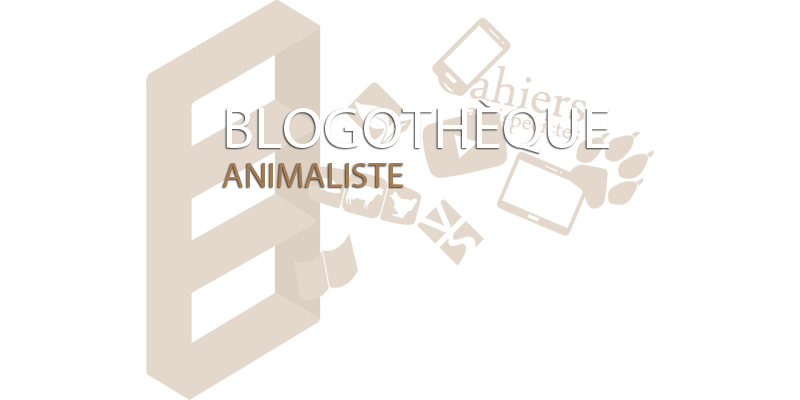
Une réflexion sur l’anthropomorphisme et son refus spéciste à partir d’un court métrage, « Battle at Kruger », de David Budzinski et Jason Schlosberg (2004).
Mots-clés: anthropomorphisme, spécisme, cinéma, court-métrage, documentaire, cinéma. -
Table ronde entre chercheur-e-s qui retrace l’histoire des rapports animaux-humains.
Mots-clefs: histoire, animaux, humains. -
> 30mnintermédiaire
Deux historiens abordent la consommation de cochon dans l’Egypte ancienne et celle du lièvre au Moyen Âge, un regard croisé qui permet de se pencher sur des sources très anciennes et de saisir l’origine des premiers interdits alimentaires (audio).
Mots-clefs: lapin, lièvre, porc, tabou, interdit, alimentation, viande, histoire. -
< 10mnintermédiaire
Les causes des violences à l’encontre des animaux sont souvent classées en deux catégories : les perturbations psychologiques individuelles et les normes culturelles. Cet article utilise les exemple de mutilations ou de meurtres d’animaux domestiques pour illustrer la première, et de l’industrie du cinéma pour illustrer la seconde.
-
< 10mnexpert
Les partisans de divers mouvements de justice sociale se soutiennent régulièrement mais les groupes de défense des droits des animaux restent en dehors de ce cercle de solidarité progressiste. Will Kymlicka l’explique, au delà de l’intérêt personnel et du désengagement moral, par la remise en cause de leur pilier philosophique central : l’« humanisme ».
-
< 15mnintermédiaire
Compte rendu de travaux de psychologie sociale de Benoît Monin et Julia Minson parus en 2007 et 2012, expliquant pourquoi le sentiment d’infériorité morale risque d’être mal vécu, et les réactions de défense qu’il déclenche dans ce cas.
-
< 15mnintermédiaire
Xavier Gravelaine présente l’importance d’offrir aux élèves de terminale la possibilité de réfléchir au bien-fondé du spécisme en montrant des images de ce qu’endurent les animaux d’élevage. Ce professeur de philosophie récuse les accusations de prosélytisme et d’endoctrinement et décrit le phénomène de censure s’exerçant sur lui en défense de l’idéologie carniste.
Commentaires (2)
Bonjour, J'ai accidentellement mis une étoile pour cet article et impossible de corriger.. Et ca m'ennuie beaucoup car je le trouve au contraire, instructif et pertinent. Si vous pouviez corriger (je mettrais 5 étoiles) ou annuler ce vote.. Merci -
> 30mnexpert
Le mouvement antispéciste actuel, majoritairement de gauche et dont la morale se centre sur les individus, porte un discours inaudible pour une grande partie de la population. Selon Pierre Sigler, les enseignements de la psychologie morale et politique devraient amener le mouvement animaliste a formuler des messages plus conformes à la diversité des intuitions morales.
-
< 30mnintermédiaire
Cette vidéo expose les différentes manières de représenter (ou non) les animaux dans les publicités françaises. Elle aborde entre autres l’invisibilisation des individus et en ne les représentant que sous la forme de produits, la happyfication ou suicide food (présentations d’animaux heureux de vivre l’exploitation), l’utilisation d’animaux de compagnie ou sauvage comme facteur d’attractivité.
-
> 30mnexpert
Enquête sociologique de Jocelyne Porcher auprès d’éleveurs en désarrois face à ce que leur métier leur demande de faire subir aux animaux. Critique du concept de bien-être animal, qui mène selon elle à adapter les animaux aux productions animales, plus que l’inverse.
-
< 30mnintermédiairehttps://youtu.be/T2xg30k80Rk
Comment se détacher du carnisme fait se rendre compte de nombreux problèmes qui passent habituellement inaperçus, et change le quotidien. Sujets abordés : Publicités, étales, formatage carniste, vision de l’élevage, spécisme intériorisé, manque d’information, etc. Format texte : https://www.mamanvegane.fr/2018/09/24/toutes-ces-choses-que-je-ne-voyais-pas-avant-d-%C3%AAtre-v%C3%A9gane/
-
< 10mnintermédiaire
En surface, les débordements anti-véganes sont contre-intuitifs : en décidant de nuire au moins de créatures vivantes possible, les véganes deviennent source de colère. Raisons rapportées : le traitement médiatique déséquilibré, la mise en question de sa propre moralité, la mise en question des normes sociales, l’adhésion à des valeurs de droite, la protection face à la dissonance cognitive.
Commentaires (2)
Lien brisé -
> 30mnintermédiairehttps://www.rts.ch/play/tv/dans-la-tete-de/video/dans-la-tete----dun-carnivore?id=10479093
A quels mécanismes psychologiques faisons-nous consciemment ou inconsciemment appel pour nous placer au-dessus du règne animal? L’émission « Dans la tête de » aborde la dissonance cognitive, le carnisme, la mentaphobie et les capacités cognitives des animaux.
-
< 10mnintermédiaire
Cet article discute de ce que peut être l’étrange amour des éleveurs pour leurs animaux, de la pertinence qu’ils trouvent à en parler et de pourquoi cette question devrait intéresser les personnes qui agissent pour l’abolition de l’exploitation animale. Quel genre d’amour peut se concilier facilement avec l’envoi à l’abattoir ?









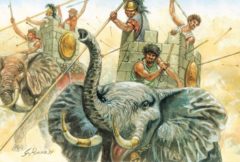











Commentaires (0)